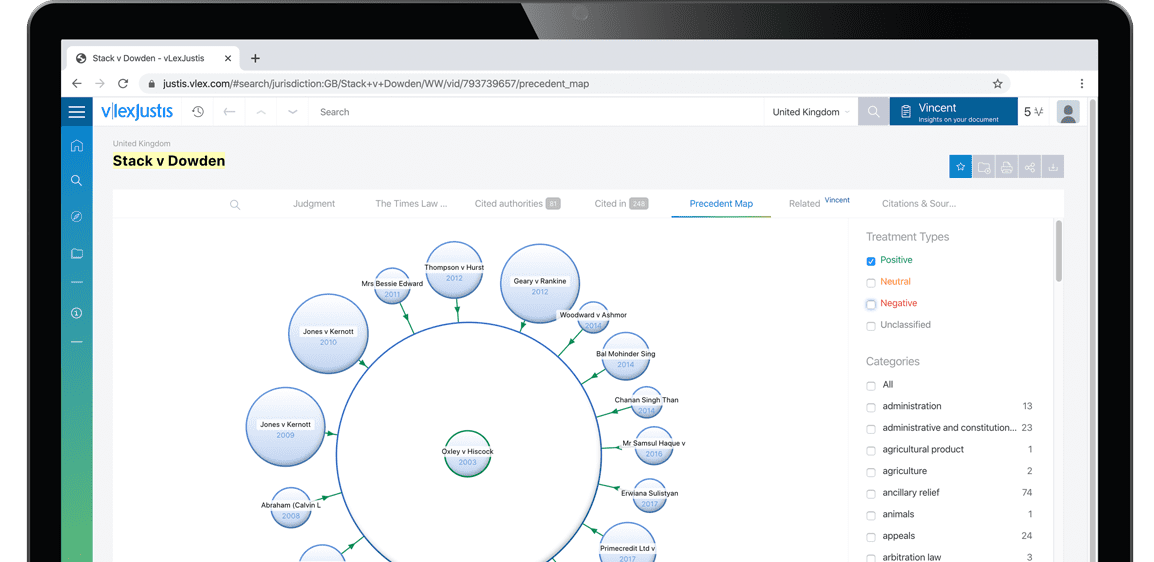La juridictionnalisation du droit dans les espaces sous-régionaux en Afrique
| Pages | 10-22 |
| Published date | 01 November 2020 |
| Date | 01 November 2020 |
| DOI | 10.3366/ajicl.2020.0329 |
| Author |
Lorsque le regard du processualiste comparatiste se porte sur le continent africain, il est saisi d'un double constat apparemment contradictoire. Il est frappé d'une part du faible recours au juge national voire la relative faiblesse des appareils judiciaires nationaux et d'autre part de la multiplication des juridictions supranationales. Pourquoi, alors que le recours au juge national est secondaire assiste-t-on à une montée en puissance des juridictions supranationales qui sont appelées à construire des réponses normatives au-delà des cas qui leur sont soumis ? Peut-on établir un lien entre la faiblesse des juridictions nationales et la multiplication des juridictions supranationales ?
Sans doute convient-il de nuancer ce double constat et ces questions de départ. Les appareils judiciaires nationaux – si tant est qu'il puisse être possible de parler d'eux en termes génériques – se transforment et se renforcent, on pense notamment aux cours constitutionnelles, mais pas seulement
Il convient aussi de nuancer ou d'expliciter l'intitulé choisi. On parle volontiers de juridictionnalisation du droit international pour décrire la multiplication des juridictions internationales alors que jusqu'à une époque relativement récente le droit international se caractérisait par sa faible juridicité. Or, comme l'a souligné Laurence Burgorgue-Larsen, « si le bruissement juridictionnel est aujourd'hui à son zénith, les juridictions régionales y sont pour beaucoup »
Après avoir exposé le phénomène de juridictionnalisation et tenté d'en expliquer les fondements (I), nous pointerons les défis et questions nouvelles qu'il pose à l'ordonnancement normatif et juridictionnel (II).
La juridictionnalisation du droit ou plus largement la montée en puissance du juridictionnel est un phénomène global qui n'est pas propre au continent africain. La juridictionnalisation du droit régional en Afrique peut s'expliquer par un certain mimétisme institutionnel (A). Mais cette explication est insuffisante. Il nous semble en effet et c'est l'hypothèse de départ que la juridictionnalisation répond à un besoin de droit ou à besoin que le droit soit dit, qui est bien particulier sur le continent africain (B).
Julie Allard et Antoine Garapon ont exposé dans leur ouvrage
« Le fait régional juridictionnel » pour reprendre la belle expression de Laurence Burgorgue-Larsen, n'est pas une spécificité du continent africain. « Qu'on juge, vingt juridictions régionales couvrent trois continents sur cinq »
Trois (CADH, Cours UA et CEA) voient leur compétence étendue à l'échelle de la région-continent ; une (l'Instance judiciaire de l'UMA) est compétente à l'échelle du Maghreb ; trois se trouvent localisées dans la sous-région d'Afrique de l'Est (les Cours EAC, COMESA et le Tribunal-SADC) ; quatre autres ont pour rattachement territorial tant l'Afrique Centrale (Cours CEEAC et CEMAC) que l'Afrique de l'Ouest (Cours CEDEAO et UEMOA), tandis qu'une seule est à cheval sur les sous-régions Centre et Ouest africaines, il s'agit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA). Les autres régions-continent sont moins prolifiques. Les continents américain et européen en comptent respectivement quatre
To continue reading
Request your trial